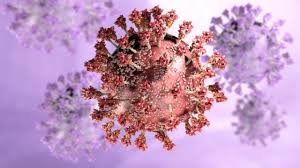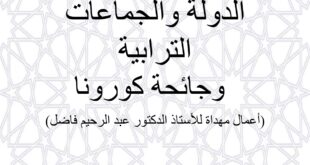au continent africain et c’est un pari qui aura ses résultats et ses
La nouvelle menace Covid 19 et la question de la sécurité nationale
BELABADA KHALID
: Doctorant chercheur en Droit public et Sciences politiques
Introduction :
A l’ère de la mondialisation, les menaces transnationales[1]se multiplient. Ainsi, le Coronavirus est devenu une menace transnationale parmi tant d’autres[2]. Il est un problème crucial dans de nombreux Etats[3]car il représente une menace majeure[4] pour l’Etat et entraîne de graves conséquences pour les victimes, l’économie et le développement social à l’échelle nationale qu’internationale.
Les virus sont aussi vieux que les cellules constituant les organismes terrestres et certains scientifiques pensent même que les premiers sont probablement issus des seconds. Le virus de la Covid-19, le SARS-CoV-2, comme les autres betacoronavirus, appartient à la très large famille des Coronaviridae[5]. Constitués notamment d’un ARN simple-brin de grande taille, ils sont en constante mutation et évolution[6].
Si le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière et de la Covid-19, leurs propagations ont été relativement lentes et ont concerné finalement beaucoup moins de cas. Enfin, si Ebola fait trembler l’Afrique et le Monde, avec un taux de mortalité considérable (de l’ordre de 40 à 50% avec 15.000 décès depuis 1976), sa dissémination a été beaucoup, beaucoup plus lente que celle du SARS-CoV-2[7].
Ainsi, s’il est reconnu aujourd’hui que la pandémie de grippe espagnole de 1918, due à une souche H1N1, a tué entre 50 et 100 millions d’individus, plus que la peste noire,
En effet, la lecture attentive des données récentes, et maintenant disponibles, semble confirmer l’impérieuse nécessité de considérer la maladie à coronavirus 2019 (Covid- 19), maladie infectieuse causée par le coronavirus SARS-CoV-2, avec beaucoup de sérieux et de pragmatisme. Ceci n’exclut pas, bien au contraire, de rester positif et optimiste grâce à la rigueur d’analyse des faits, en évitant la panique née de l’ignorance, de l’incohérence d’attitude ou de la course au sensationnel[8].
Cette épidémie s’accélère. Depuis sa propagation en dehors des frontières de la Chine, le coronavirus a été détecté dans plus de 137 pays à travers le monde dont le Maroc.
Dans cet ordre d’idée, la menace de Corona virus n’est plus une question de sécurité sanitaire locale mais internationale, elle a des répercussions sur d’autres secteurs. Elle peut s’avérer une question de sécurité nationale vu ses impacts socio-économiques qui peuvent se dégénérer en problèmes politiques. Telle est l’idée centrale qui va servir comme toile de fond à notre sujet.
En effet, pour cette raison-là, on essaie d’insister sur :
- Sur le principe de l’indissociabilité entre les secteurs de sécurité. Autrement dit, une question de sécurité environnementale peut engendrer de graves problèmes à d’autres secteurs, à titre d’exemple, le secteur économique ;
- La perception de la menace diffère d’un Etat à un autre[9];
- La lutte contre cette épidémie se base sur une culture de discipline et de solidarité ;
- La gestion de cette menace nécessite d’approfondir le niveau d’analyse pour atteindre l’individu.
Et pour décortiquer notre sujet, on va adopter le plan suivant qui se décline ainsi :
Section I : La sécurité nationale et la lutte contre le Coronavirus : quelle articulation ?
Section II : La gestion de la menace liée à l’épidémie Corona
I- La sécurité nationale et la lutte contre le Coronavirus : quelle articulation ?
Avant d’entamer la question de la corrélation qui existe entre le virus et la sécurité nationale. Il est inévitable d’insister sur la définition des concepts de : menace et sécurité en vue d’expliciter la complexité tant de la lutte que de ses incidences socio-économiques.
- La perception de la menace
Le concept de perception de menace est apparu aux États-Unis à la fin des années 1950 dans le contexte de l’après-guerre et de la bipolarité États-Unis/Russie. En effet, l’histoire de la théorie de la perception de menace est celle d’une longue tentative de prouver 1’influence de facteurs particuliers sur la perception.
Depuis les tous débuts du concept, on tente de repérer les variables composant et déterminant la perception d’une menace. Les différentes combinaisons proposées par les théoriciens comprennent tant des facteurs internes qu’externes.
Dans ce sillage, la perception de menace présuppose trois composantes : un perceveur, un objet et un processus qui permet la perception par le perceveur de l’objet.
Selon le théoricien politique de la perception de menace Raymond Cohen, « la perception de menace n’est rien de moins que la variable intervenante décisive entre un évènement et une réaction[10].».
En effet, six facteurs internes agissant comme prédispositions rassemblent plus d’un adepte parmi les théoriciens et nous laissent croire à la possibilité d’une influence plus marquée. En ordre de popularité, ceux-ci sont : la mémoire historique (celle des événements internationaux importants, du comportement de l’ennemi et des expériences passées[11]); les différences socioculturelles , idéologiques et identitaires[12]; les aléas de la bureaucratie[13]; la personnalité[14]; le système politique[15] et les intentions du perceveur[16].
Ainsi, on peut pousser notre analyse en insistant sur la question de la perception étatique qui s’effectue au niveau des décideurs politiques. Jervis affirme qu’« […] il est souvent impossible d’expliquer les décisions et politiques cruciales sans faire référence aux idées sur le monde des décideurs politiques et à leurs représentations des autres[17] ».
Dans ce sens, les décideurs politiques sont en en position d’autorité. Le meilleur accès aux ressources et moyens de communication que leur occasionne cette position assure aux décideurs politiques une plus grande force de persuasion au sein du discours social[18]. Ainsi, Sa majesté le Roi exhorte le Gouvernement à prendre les mesures de précautions nécessaires pour endiguer et lutter contre cette épidémie qui ne cesse de ravager les pays de par le monde.
Dans cet esprit d’idées, la perception de menace est observable dans les déclarations des décideurs politiques et par ricochet dans les lois, les règlements…etc. Les théories qui s’intéressent au discours avancent que le langage informe et influence la perception de la réalité et qu’il a une incidence directe sur le comportement humain[19]. Elles reposent sur 1’idée que le langage et 1’utilisation du langage ne font pas que refléter et représenter les réalités sociales et mentales mais construisent et constituent ces réalités[20].
Dans le cas d’une menace, c’est le fait de la nommer menace qui lui donne une existence en tant que telle, qui l’introduit comme une réalité dans l’éventail des menaces qui affligent un État[21]. Selon Ole Waever, l’existence d’une menace est le résultat d’un acte de langage. C’est en étiquetant quelque chose comme une question de sécurité qu’il en devient une[22]. C’est ainsi que le virus est devenu une question de sécurité nationale dans le monde, et bien évidemment au Maroc.
2. La sécurité nationale
Définir le vocable sécurité n’est pas une chose aisée. Non pas tant à cause de son insertion dans la plupart des domaines de la vie sociale, mais surtout parce que le concept est lui-même susceptible d’être connoté idéologiquement.
Ainsi, le problème se complique lorsque l’on veut définir la « sécurité nationale ». Il tient à la nature de l’État qui recouvre à la fois une idée, une institution et une base physique. L’État est en même temps une structure organisationnelle complexe, une collectivité et un instrument de politique. En ce sens, l’État est donc d’abord un instrument de promotion de la sécurité avant d’être le sujet ou le référent de la sécurité. Selon Helga Haftendorn, la sécurité nationale est le produit direct de l’institutionnalisation progressive de l’État souverain depuis le XVIIe siècle.
Dans ce sillage, le professeur Barry Buzan affirme que dans le cas de la sécurité, la discussion consiste à se soustraire à la menace[23]. Cette discussion se double d’une interrogation sur la construction discursive de la menace, expliquant l’utilisation du concept de « sécuritisation », c’est-à-dire la désignation d’un objet comme étant une menace, par une autorité légitime.
Ainsi, la sécuritisation est une construction pragmatico-linguistique qui transforme un sujet donné en question de sécurité. En d’autres termes, la sécuritisation actualise rhétoriquement une anxiété, une situation d’incertitude, alors que la sécurisation est l’art de sécuriser, c’est-à-dire l’art de mobiliser un ensemble de moyens financiers et humains afin de mettre en œuvre une gamme de pratiques permettant de fiabiliser un espace sociopolitique spécifique. En un mot, la sécuritisation précède la sécurisation.
Dans cette lignée, il est nécessaire d’affirmer que la question de sécurité nationale s’étudie en termes de menaces et de vulnérabilités. Ainsi, la fonction de sécurité d’un État répond souvent à une évaluation de ce couple qui conditionne, en dernière instance, son effectivité. Le problème qui s’impose est que même s’il est relativement faisable d’évaluer la vulnérabilité, il est plus complexe d’apprécier la menace.
Ainsi, la perception de cette dernière, lorsqu’elle est voilée par la peur ou par l’angoisse, sape les capacités rationnelles des différents acteurs socio-économiques et paralyse toute tentative de formuler des politiques adéquates. Le deuxième écueil dans l’évaluation de la menace se situe dans la détermination du degré suffisant de menace qui risque de porter atteinte à un point vital de l’Etat.
2.1 La sectorisation :
L’étendue de la sécurité nationale est tout simplement immense. Néanmoins, le référent-État de la sécurité nationale fait face à quatre secteurs distinguables dans l’abstrait, mais noués dans la réalité. Ce sont en fait des secteurs prioritaires qui semblent être des vecteurs de vulnérabilités accentuées : les secteurs économique, environnemental[24], politique et sociétal.
Dans ce sens, les secteurs ne sont que des lentilles analytiques à travers lesquelles le chercheur enquête sur l’état de tout le système par rapport à un référent donné. En outre, le concept de sectorisation permet d’avoir une image approfondie de tout le système à travers une lentille sélectionnée. La métaphore de la lentille est fort utile. Ainsi, les secteurs forment un réseau d’intelligibilité de la scène internationale et, à ce titre, sont indissociables.
Le schéma[25] ci-dessous illustre bel et bien cette question du principe de l’indissociabilité. Il s’organise en deux grands axes, vertical et horizontal. Le premier délimite les niveaux d’analyse et le second porte sur les secteurs saillants pour la sécurité nationale en général. Il reprend les termes d’« élargissement» pour les secteurs et d’ « approfondissement» pour les niveaux.
En guise de résumé, quelle que soit l’unité d’analyse (individu, État, région, globe), la sécurité peut être abordée subjectivement et/ou objectivement.
En ce qui concerne notre sujet, la sécurité environnementale a un impact non négligeable sur les autres secteurs, à savoir : le secteur politique, le secteur économique et bien entendu, le secteur sociétal.
En guise de conclusion, la pandémie du corona virus s’avère une vraie menace qui nécessite une gestion en vue de l’endiguer et d’atténuer ses impacts.
II- La gestion de menace liée l’épidémie Corona
Le lien perçu entre la menace du Covid 19 et la sécurité a légitimé et continue de légitimer la mise en œuvre et l’application de réglementations et de contrôles plus stricts en matière de lutte contre ce fléau.
- L’installation d’un centre d’opérations d’urgence[26]
Le diagnostic clinique et le traitement des patients atteints ne constituent qu’un élément de la réponse globale à une épidémie. Celle-ci doit être dirigée par un centre d’opérations d’urgence.
Un gestionnaire d’incidents doit diriger le C.O.U et superviser l’intervention. Plusieurs groupes, ou piliers, devraient fonctionner sous l’égide du C.O.U. L’équipe de gestion des cas assure l’isolement et le traitement en toute sécurité des patients suspectés et confirmés d’être atteints de maladies sexuellement transmissibles. Tous les établissements de santé doivent disposer de systèmes solides pour dépister les symptômes des maladies sexuellement transmissibles chez les patients et pour les isoler dans une salle ou un établissement désigné. Il est essentiel de garantir les normes les plus élevées de contrôle des infections de protéger les travailleurs de la santé et de prévenir la transmission nosocomiale. Il peut être nécessaire de créer une ou plusieurs unités de traitement du virus afin de disposer d’installations séparées et spécialisées où les cas suspects ou confirmés peuvent être traités. Le groupe de laboratoires garantit que les services de diagnostic des maladies sexuellement transmissibles sont largement disponibles et que les tests soient effectués rapidement. Ils veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour l’emballage et le transport sûrs des échantillons, la fiabilité des tests et la communication rapide et appropriée des résultats.
L’équipe chargée des enterrements veille à ce que les patients atteints du virus soient enterrés dans la sécurité et la dignité, car les enterrements dangereux sont considérés comme une voie de transmission importante. En fonction de la nature de l’épidémie, des critères spécifiques doivent être élaborés pour déterminer si seuls les corps des patients confirmés doivent être inclus dans cette politique, ou également les cas suspects ou tous les décès. Enfin, le groupe de coordination doit faciliter la communication et la collaboration entre les autres groupes et faciliter les questions transversales telles que le financement, la logistique et la chaîne d’approvisionnement pour la réponse.
- Questions critiques pour une réponse réussie au Covid 19 : des leçons tirées de l’épidémie d’Ebola[27]
L’épidémie de fièvre aphteuse en Afrique de l’Ouest en 2014-2015 a mis en évidence un ensemble de questions critiques et transversales qui sont fondamentales pour une réponse efficace au virus Ebola.
- Engagement de la communauté : La réponse doit être faite avec les communautés, plutôt que de leur être faite. Il doit être au premier plan et considérer que c’est l’affaire de tous. L’histoire de la méfiance de nombreuses communautés à l’égard du gouvernement et des étrangers a constitué un défi important. Un autre problème était que de nombreuses personnes ne voyaient pas la maladie sous l’angle biomédical mais sous l’angle spirituel[28], et que la plupart des messages de santé publique n’étaient pas en rapport avec les croyances traditionnelles en matière de santé. La réponse doit comprendre ces facteurs et y répondre ;
- La transparence dans la réponse : Les tentatives de dissimulation ou de dissimulation des données relatives à l’épidémie peuvent constituer un défi particulier, qui peut considérablement miner les efforts déployés par les intervenants pour la contenir. Il est essentiel que le C.O.U maintienne la transparence et dispose de l’espace politique nécessaire pour prendre des décisions fondées sur les preuves et la politique convenue ;
- Capacité du système de santé : La capacité préexistante du système de santé en Afrique de l’Ouest était limitée, ce qui a fourni une base faible pour la réponse. De nombreux établissements de santé étaient surpeuplés et manquaient d’infrastructures ou de fournitures essentielles pour lutter contre les infections, comme l’eau courante ou le savon dans les salles. Les pénuries de personnel étaient souvent graves, et il y avait un manque particulier de superviseurs cliniques tels que des médecins consultants ou des infirmiers supérieurs, pour assurer le maintien des normes. Il n’y avait pas de systèmes cliniques solides en place, tels que le regroupement des patients à haut risque par cohorte ou le dépistage ;
- Motivation et responsabilité du personnel : Au centre de cette situation se trouve le faible niveau de motivation et de responsabilité du personnel de santé. Dans ce contexte, il était essentiel d’assurer un meilleur moral et une meilleure supervision des équipes de travailleurs de la santé. Il s’agissait notamment de définir les rôles clés du personnel, de veiller à ce qu’il soit incité à travailler par le biais d’une prime de risque ou d’une indemnité de risque, d’introduire des primes basées sur les performances, et de reconnaître et célébrer publiquement les succès. Le personnel doit également être assuré qu’il recevra le meilleur traitement médical s’il tombe malade ; la réussite de l’essai d’un vaccin sera probablement un facteur de changement dans la réduction des infections chez les travailleurs de la santé et dans leur volonté de traiter les patients atteints de maladies sexuellement transmissibles ;
- Commandement et coordination : Une réponse à ce virus implique de multiples parties mobiles, y compris dans le cadre de la gestion des cas. Cela comprend la surveillance de la capacité en lits des différentes unités, la réception des cas suspects de la communauté, l’orientation des patients séropositifs pour les maladies sexuellement transmissibles vers une unité de soins intensifs, le transport des échantillons de sang et la diffusion des résultats de laboratoire, la distribution des fournitures essentielles et la liaison avec les équipes d’inhumation. La coordination de ces activités peut imposer une lourde charge au personnel clinique supérieur et créer le chaos si plusieurs établissements sont en concurrence pour les mêmes services de soutien. Dans cette situation, il est conseillé de mettre en place un centre de commandement dédié pour gérer cette coordination et cette logistique ;
- Quarantaine et restriction[29] : Lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016, de nombreux noms différents ont été utilisés pour décrire les unités d’isolement[30] d’Ebola, notamment “unités de détention”, “unités d’isolement”, “unités de soins” et “centres de soins”. Elles peuvent être installées dans des bâtiments existants ou sous forme de tentes. Les principales composantes sont les suivantes[31] :
- Espace de dépistage ;
- Zone d’habillage du PPE pour le personnel ;
- Zones réservées aux patients (idéalement divisées en zones “humides” et “sèches” pour les patients à risque élevé et faible) ;
- Zone de décontamination pour le personnel ;
- Incinérateur et fosse à déchets ;
- Zone de stockage des corps ;
- Magasins de fournitures générales et de médicaments ;
- Bureau.
Cependant, pour les établissements de santé, un dilemme majeur était de savoir s’il fallait enfermer les patients dans des installations d’isolement et les empêcher physiquement de se décharger d’eux-mêmes. En effet, il est nécessaire d’insister sur le risque de maladies sexuellement transmissibles. Un risque que pourrait encourir l’entourage du patient[32].
- Maintien des services de santé généraux pendant une épidémie : Cela nécessite un excellent dépistage et un contrôle des infections, en maintenant la confiance du public et en donnant la priorité aux services de santé généraux dans la réponse. Des mesures de santé publique innovantes doivent être envisagées ; par exemple, l’administration massive de traitements contre la malaria….
Conclusion :
Chaque épidémie sera contextuelle, acheminée dans une zone géographique, un contexte politique, un point dans le temps et un système de santé particuliers. En effet, la réponse opérationnelle globale dépendra toujours du système de santé sous-jacent, avec des défis importants à relever dans des contextes de faibles ressources.
Dans cet esprit d’idées, le Maroc doit tirer des leçons de cette situation et tirer profit de ses expériences de lutte en vue d’anticiper et d’endiguer ce genre de menaces transnationales dans le futur. En un mot, on a besoin d’un retour d’expériences sur notre gestion de cette pandémie afin de capitaliser les connaissances dans le domaine de la gestion des risques sanitaires.
[1] Le vocable transnational évoque la question de sa propagation dans plus d’un Etat
[2] A titre d’exemple : le terrorisme, le crime organisé….
[3] Par exemple, ils sont au stade 3 de l’épidémie les Etats suivants : La France, l’Italie et l’Espagne. Il signifie que le coronavirus Covid-19 circule dans tout le pays, sans que ces Etats arrivent à isoler tous les malades.
[4] « Nous sommes en guerre », a martelé Emmanuel Macron lors de son allocution du 16 mars 2020.
[5] La famille des Coronaviridae comprend les Coronavirus et les Torovirus. Seuls les Coronavirus infectent l’homme. Ces virus sont des pathogènes importants en médecine vétérinaire. Chez l’homme, ils sont essentiellement connus comme des agents du rhume. Voir : https://www.em-consulte.com/article/61411/coronaviridae (consulté le 17/03/2020).
[6] Ce virus est comme le virus Ebola, il est relativement fragile et vulnérable aux :
- Chlore ;
- Alcool et formaldéhyde ;
- Savon ;
- Chaleur.
[7] https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/la-covid-19-est-un-reel-danger-deux- scientifiques-font-le-point-sur-le-coronavirus-sars-cov-2 (Consulté le 17/03/2020).
[8]https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/la-covid-19-est-un-reel-danger-deux- scientifiques-font-le-point-sur-le-coronavirus-sars-cov-2 (Consulté le 17/03/2020).
[9] La chine et l’Iran voient ce Virus comme un virus issu d’une industrie bactériologique américaine. Les Etats-Unis voient que c’est un virus chinois.
[10] Cohen Raymond, Threat Perception in International Crisis. Madison (WI) The University of Wisconsin Press, 1979, p.3.
[11] Raymond Cohen, idem, p. 84.
[12] Bauer Raymond A. « Problems of Perception and the Relations between the United States and the Soviet Union »., in Journal of Conflict Resolution, vol. 5, no 3 (September 1961), pp. 226-228.
[13] Jervis Robert, Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, 1976, p.286.
[14] Raymond Cohen, op.cit, p. 114; voir aussi: Knorr Klaus, « Threat Perception », Chap. in Historical Dimensions of National Security Problems, University Press of Kansas, 1976, p.113.
[15] Raymond Cohen, op.cit, pp. 116-135.
[16] Bauer, op.cit., p. 224.
[17] Jervis Robert, op.cit., p.28.
[18] David L., Identifying Threats and Threatening Identifies: The Social Construction of Realism and Liberalism, Stanford (CA) , Stanford University Press, 2006,p.73.
[19] Mely Caballero-Anthony et Ralf Emmer, « The Dynamics of Securitization in Asia », in Studying Non-Traditional Security in Asia: Trends and Issues, Ralf Emmers, Mely Caballero-Anthony et Amitav Acharya (dir.), Singapore: Marshall Cavendish, 2006, p. 24.
[20] Michael Karlberg, « Discourse Theory ». in The Encyclopedia of Peace Psychology, Daniel J. Christine (dir.), vol. 1 (A-1-1), West ussex (Royaume-Uni): Blackwell Publishing Ltd, 20 12, p. 347
[21] Le Maroc considère Coronavirus comme une menace à sa sécurité.
[22] Ole Waever, « Securitisation: Taking Stock of a Research Programme in Security Studies », Février 2003, pp.10-11.
[23] Thierry Balzacq, Qu’est-ce que la sécurité nationale ?, in Revue internationale et stratégique 2003/4 (n° 52), pp. 33 à 50.
[24] La sécurité environnementale s’identifie à la qualité de la biosphère.
[25] Thierry Balzacq, op.cit., pp. 33 à 50.
[26] Marta Lado, Ebola Virus Disease: A Manual for EVD Management, Springer International Publishing, 2018, pp.3-4.
[27] Marta Lado, Ebola Virus Disease: A Manual for EVD Management, op.cit., p.5.
[28] هنا يمكننا الحديث عن الشيخ السلفي المدعو أبو النعيم، الذي اعتقلته الشرطة القضائية التابعة لدائرة المحكمة الاستئنافية بالرباط المتخصصة في الجرائم الارهابية، عندما قام بتسفيه جهود الدولة في محاربة وباء كورونا..
[29] Les principaux processus de mise en place et de fonctionnement d’une unité de détention Ebola sont les suivants :
- Construction ;
- Formation ;
- Personnel ;
- Entretien des installations ;
- Paiement de l’indemnité de risque ;
- Fourniture de fournitures médicales et d’EPI ; « Personal Protective Equipment »
- Fourniture de fournitures non médicales (draps, carburant pour générateur, etc.) ;
- Supervision et inspection (fournir des conseils techniques et évaluer la sécurité et les soins cliniques).
[30] Marta Lado, Ebola Virus Disease: A Manual for EVD Management, op.cit., p.20.
[31] Idem, pp.21-21.
[32] Ici on peut évoquer la question de zonage selon la terminologie qui est souvent utilisée :
- Zone verte pour les zones où il n’y a aucun contact avec les patients et aucun risque d’exposition pour le personnel ;
- Zone rouge pour les zones à l’intérieur de l’unité de détention où se trouvent des patients et des déchets infectieux.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية