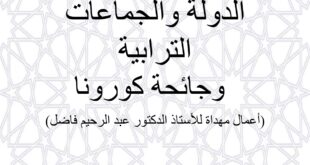LE MANAGEMENT EMOTIONNEL OU COMMENT CRÉER
DES LIENS AFFECTIFS QUI RENFORCENT L’EFFICACITÉ
| Joel MOULHADE Docteur en gestion Professeur Skema business School (2018) Maître de conférences à l’Université du Littoral (2014) Prix « stylo d’or de la chambre de commerce et d’industrie de Paris » (2004) | SHAAT Ashraf Docteur en droit, ancien Doyen de la faculté de droit de Dubaï Professeur a l universite de Zaid-dubai |
Résumé
Cet article, présente un tour d’horizon sur le développement actuel du concept d’intelligence émotionnelle de l’environnement et de la gestion des hommes dans le contexte particulier des maisons de repos.
Si la notion de management doit être précisé, il est important de la resituer dans ce cadre où les parties prenantes possèdent des caractéristiques bien établies.
Dans un premier temps, nous rappelons brièvement les différentes notions utilisées à savoir les différentes composantes du management, de l’intelligence émotionnelle et des émotions.
Dans un deuxième temps, nous présentons les différents modèles élaborés par les chercheurs sur le management émotionnel et ses composantes.
Enfin, nous analysons les différentes émotions, les méthodes et les outils opérationnels utilisés pour les reconnaître et les mettre en œuvre dans le management émotionnel.
Pour aborder le sujet, nous devons d’abord préciser les trois notions les plus importantes de cet exposé qui sont le management, l’intelligence et les émotions. C’est au croisement de ces concepts que se forge le management émotionnel. Cependant on comprend très vite que les trois termes sont difficiles à cerner tant leur utilisation est à la fois courante et diverse dans leurs expressions.
Tableau n°1 Les composantes du management émotionnel
MANAGEMENT
ÉMOTION MANAGEMENT ÉMOTIONNEL
INTELLIGENCE
I- LE CONCEPT DE MANAGEMENT
Le management[1] est le terme plus ancien[2] des trois ; polysémique, il est complexe à appréhender du fait de ses multiples acceptions mais aussi de l’évolution rapide de son contenu et de sa propension à englober de nouvelles techniques. Ainsi on peut essayer de dresser un tableau de différents types de management. Il ne prête pas à être exhaustif.
Tableau n°2 Les différents types de management
| Management méthode de gestion des hommes et des équipes | Management des organisations | Management opérationnel | Management fonctionnel et technique |
| Participatif, directif, collaboratif, émotionnel, Leadership, consultatif, Autocratique, intégrateur, Interculturel, attentiste, Négociateur… | Projet, organisation, Public, Organisationnel, Transversal… | De la qualité, De proximité, Par objectif… | Stratégique, marketing, Financier, production, Comptabilité, Communication, Des Ressources Humaines.. |
Cette approche superficielle mais large dans sa dimension nous démontre l’ampleur du concept et surtout son aptitude à s’associer à des environnements divers pour envahir de nouveaux champs de recherche.
Dans notre présentation, nous traiterons du management et de la gestion des hommes mais dans un contexte particulier qui met en relation des hommes, des méthodes et des actions dans le milieu des personnes âgées.
Les hommes, contrairement à une entreprise traditionnelle, ont des caractéristiques spécifiques puisqu’ils peuvent être atteints de déficiences physiques, mentales ou psychologiques.
L’autre particularité est que le management des personnes dans des maisons de retraite peut faire l’objet d’intrusion de la part des parties prenantes proches (parents ou enfants).
Cette particularité introduit une importance accrue de l’aspect émotionnel dans la relation et donne ainsi une valeur supplémentaire à la notion de management émotionnel dans ce secteur.
II- LE CONCEPT DE L’INTELLIGENCE
Le concept de l’intelligence artificielle est apparu à la fin du 19ième siècle avec les recherches de F. Galton[3] sur la mesure de l’intelligence, puis C. Spearman[4] qui détermine au début du 20ième siècle un indice global qu’il nomme le facteur g pour intelligence générale.
A la même époque, A. Binet[5] développe des recherches sur la phrénologie qui seront reprises par le neurologue Allemand F. J. GALL[6]. Elles aboutiront par la suite à l’élaboration grâce à une collaboration entre A. Binet et le docteur H. Simon[7] à l’échelle psychométrique dénommée “échelle métrique de l’intelligence”. Elle est basée sur le concept “d’âge mental” calculé par la moyenne d’âge des enfants capables de réussir une tâche demandée par le test.
En 1916, L. Terman[8] modifie le test de Binet sur la base des travaux W. Stern[9] en calculant le rapport entre les résultats obtenus au test de Binet-Simon et l’âge des enfants. C’est à partir de cette époque que L. Terman donnera au nouveau test le nom de Stanford-Binet. Il sera calculé selon la formule de l’âge mental divisé par l’âge chronologique de l’enfant et multiplié par 100 et sera dénommé le quotient intellectuel (QI). Le concept de l’intelligence était ainsi défini et sa principale dimension était cognitive.
Cette vision de l’intelligence au fil des approfondissements est vite apparue comme restrictive, n’expliquant pas toutes les capacités d’adaptation de l’être humain.
Le concept de l’intelligence, s’il a bien été défini pour détecter l’intelligence, n’a pas encore fait l’objet d’analyse de l’évolution de l’intelligence au cours de la vie. Cela pourrait apparaître extrêmement important dans le cas de la gestion des personnes en situations particulières de faiblesse, de maladie, de fin de vie.
Avec les des personnes âgées, la notion d’intelligence est fonction évidemment de leur passé mais aussi de leur état de santé morale et physique ; elle sera de ce fait fortement influencée par l’émotionnel.
III- LE CONCEPT DE L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE
C’est en 1939 que le concept bien établi de l’intelligence est remis en cause par
L. L. Thurstone[10] qui considère l’intelligence comme un concept multi-dimensionnel avec une composante sociale.
Cette nouvelle approche sera popularisée dans le cadre des recherches de
H. Gardner[11] sur les enfants en échec scolaire. Il détermine de façon empirique neuf catégories d’intelligence (logico-mathématique, linguistique, intra-personnelle, visio-spatiale, musicale, kinesthésique, naturaliste et existentielle).
Cette nouvelle vision de l’intelligence a permis de développer des études sur la validité du QI. Il s’est avéré par ailleurs que QI n’avait pas une valeur prédictive assurée qui permettrait de prédire les résultats dans le domaine professionnel (Hunter & Hunte)[12].
Une autre étude[13] réalisée sur un échantillon de 450 garçons a montré peu de relations entre le QI et la situation dans la vie professionnelle mais a démontré la capacité à gérer la frustration, les émotions et les relations interprofessionnelles[14].
La voie au concept d’intelligence émotionnelle était ouverte.
La paternité du concept revient à P. Salovey & J. D. Mayer[15] qui la définissent ainsi :
La notion d’intelligence émotionnelle est une forme d’intelligence qui suppose l’habileté à contrôler ses sentiments, ses émotions et celles des autres. Être capable de faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses actions.[16]
C’est donc une forme d’intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et émotions et ceux des autres. Elle permet de faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses gestes.
Ainsi l’intelligence émotionnelle désigne «l’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler les émotions chez soi et chez les autres» (Mayer).[17]
Elle comprend la motivation, les émotions, les cognitions et, moins fréquemment, la conscience.
Cette définition nous oblige à nous questionner sur la notion d’émotions et d’en définir les pourtours.
Il apparaît évident, bien que cela ne soit pas prouvé scientifiquement, qu’un individu en situation de fragilité dans une situation où son corps est pour lui l’objet de contraintes développe des pratiques ou des artifices lui permettant de s’adapter au monde qui l’entoure. Cette approche est très développée pour les personnes fragilisées ou en situation physique délicate.
Cela est d’autant plus intéressant que ce monde est à la recherche pour lui de solutions rationnelles pouvant modifier son état ou lui permettre de vivre mieux son état.
L’individu est ainsi pris dans une double contrainte :
– sa contrainte propre : comprendre son état pour s’y adapter,
– son environnement humain (médecin famille) : essayant d’apporter une solution à son état à travers la compréhension qu’il a de son état.
IV- LES EMOTIONS
Le concept d’émotions a été étudié dans la Grèce antique. Ainsi les premiers, Platon et Aristote,[18] développent une réflexion sur ce thème. La vision platonicienne considère les émotions comme un élément venant pervertir les raisonnements.
Au contraire de Platon, Aristote considère les émotions comme un stimulus permettant d’évaluer le gain potentiel et le plaisir rattachés à la réalisation d’une action et il distingue trois catégories de biens : les biens du corps, les biens de l’âme et les biens de la vie.[19]
Cette vision sera reprise par Descartes[20] qui proposera une classification des passions fondamentales de l’âme en cinq catégories : l’admiration, l’amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse.
Par la suite les recherches sur les émotions se sont développées dans deux directions. L’une conserve les prémisses instillées par Platon à l’instar des behavioristes comme Carlson[21] qui considère les émotions comme peu pertinentes dans l’étude des comportements humains. Le deuxième courant mené par
S. Schachter[22] explique l’émotion par l’interaction entre les signaux corporels et la cognition.
R. Lazarus[23] démontrera plus tard que la manière dont on interprète une situation influence fortement l’émotion ressentie.
Ainsi l’émotion peut être définie au travers des différentes analyses comme un état lié à la modification d’un état initial. L’émotion désigne ce qui nous met en mouvement à l’extérieur comme à l’intérieur de nous-mêmes.[24]
L’émotion devient un facteur puissant de notre fonctionnement; elle est un indicateur qui signifie une modification de notre comportement face à un événement survenu et nous pousse à nous adapter pour augmenter nos chances de survie.
A. R. Damasio[25]considère que “même les organismes très simples éprouvent des émotions, c’est-à-dire des réactions naturelles, automatiques qui les conduisent directement ou indirectement à préserver leur corps et assurer son équilibre interne…C’est cette série de réactions, visibles ou non qui constitue ce que l’on appelle émotions”.
L’émotion devient un mécanisme d’adaptation créant une interaction entre notre environnement et notre condition de survie. Cette adaptation se réalise en quatre étapes selon I. Kotsou[26].
- l’évaluation fonctionnelle : analyse de la situation et de son importance.
- les modifications biologiques (accélération du rythme cardiaque, sueur) mais aussi expressives, gestuelles (posture, qualité de la voix).
- les tendances à l’action : l’organisme prépare une réponse en fonction de ce qu’il a perçu.
- les cognitions : l’esprit prépare une contre-attaque en fonction de ses méta-programmes.
L’analyse des différents facteurs composant l’intelligence émotionnelle a incité les chercheurs à développer de nouveaux modèles d’approche ; ainsi de nombreuses méthodes sont vite apparues dans le sillage de ces découvertes.
Nous allons présenter les plus connus, sans pour autant négliger les évolutions possibles.
Il s’agit, par ordre chronologique, du modèle de P. Salovey et J. Mayer (1990) où l’intelligence émotionnelle est une intelligence pure, c’est-à-dire une habileté cognitive.
Vient ensuite le modèle de R. Bar On (2000) qui considère l’intelligence émotionnelle comme une intelligence mixte composée à la fois d’une habileté cognitive et des traits de personnalité. Dans son modèle, Bar On fait ressortir l’influence des facteurs cognitifs et de la personnalité sur le bien-être général.
Le modèle de D. Goleman (2000) est basé sur le même schéma mais D. Goleman n’en tire pas les mêmes conclusions. Il considère que les facteurs cognitifs et la personnalité assurent le succès dans le milieu du travail.
Le modèle de Petrides et Furnham (2000) considère que l’intelligence émotionnelle est partie prenante de la personnalité.
Enfin le modèle de A. Bandura (2007) est basé sur la croyance de l’individu en ses capacités à atteindre le résultat souhaité.
Nous allons passer en revue chacun de ces modèles pour montrer leur particularité et leur intérêt dans le management des hommes.
Le modèle de P. Salovey et J. Mayer
Ce modèle est centré sur la capacité de l’individu. Il organise l’intelligence émotionnelle autour de deux dimensions : la dimension expérientielle et la dimension stratégique. Chaque branche est ensuite divisée en deux sous-parties :
La dimension expérientielle :
- la perception émotionnelle ou l’habileté à percevoir et exprimer ses émotions, la capacité à faire la différence entre les expressions honnêtes et malhonnêtes des émotions.
- l’assimilation émotionnelle ou la faculté à intégrer dans la pensée les aspects émotionnels et à distinguer les différentes émotions que l’on ressent.
[1] Selon le Journal officiel du 14/05/2005 (voir FranceTerme), ce terme est accepté en France par la DGLF qui précise qu’il ne doit pas être prononcé à l’anglaise.
[2] L’Oxford English Dictionary fait découler le terme management du vocabulaire français, et plus particulièrement du substantif « mesnage » et du verbe « mesnager » qui, au XIIIe siècle, caractérisent “l’art de gérer les affaires du ménage », c’est-à-dire « conduire son bien, sa fortune et ses domestiques de façon judicieuse”
[3] « Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature », F. Galton in Journal of the Anthropological Institute, vol. 15, 1886, p. 246-263 [texte intégral]
[4] The Abilities of Man: Their Nature and Measurement. Spearman, Charles B. (2005). The Blackburn Press.
[5] L’étude expérimentale de l’intelligence Alfred Binet (1903)
[6] Crâniologie, ou découverte nouvelles concernant le cerveau, le crâne et les organes. F.J. Gall Paris 1807
[7] Models of bounded rationality vol. 3 Empirically grounded econmic reason CambridgeMA/ the MIT press H. Simon
[8] The Measurement of Intelligence L. Terman (1916)
[9] IL est l’inventeur du QI. Son intérêt pour les différences individuelles mena au développement du concept de quotient intellectuel, le Q.I. En collaboration avec Heinz Werer, il développe une méthode de détermination du quotient intellectuel. Stern définit le quotient intellectuel comme l’union, le rapport, entre l’âge mental et l’âge chronologique multiplié par 100.
[10] “Psychophysical analysis. L. L. Thurstone, 1927
[11] Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligence H. Gardner1983
[12] Validity and utility of alternativepredictors of job performance Hunter & Hunter Psychological Bulletin 1996 PP. 72- 98
[13] How lower and working-class youth become middle-class adults : the association between ego défense mechanisms and upward sox-cail mobility J. R. Snarey & G. E. Valliant Child Developpement 1985
[14] Il en est de même avec une étude menée auprès 80 docteurs. Emotional intelligence and acdemic intelligence in career and life success G. J. Feist & F. Barron in paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Society, San Francisco CA 1996
[15] Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990). 9, pp 185-211.
[16] Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality P. Salovey & J. D. Mayer 1990 pp. 185-211
[17] Emotional Intelligence in Everyday Life: A Scientific Inquiry. Philadelphie Mayer (Eds.) Psychology Press, pp. 133-149.
[18] Psychologie des émotions. Confrontation et évitement, O. Luminet 2002 Bruxelles DE Boeck Université
[19] La philosophie des émotions, les sages nous aident à en faire bon usage J. Frère 2011 Ed. Eyrolles
[20] Les passions de l’âme œuvres philosophiques et morales Paris Bibliothèque des lettres art. 211 P 572
[21] Psychology the Science of Behaviour Carlson, Neil R. and Heth, C. Donald (2010) Ontario, CA: Pearson Education Canada. Pp 20-22.
[22] The interaction of cognitive and physiological determinants of emotional state. Schachter,S (1964) Advances in Experimental Social Psychology, ed. L. *Berkowitz, pp. 49–79. New York: Academic Press.
[23] Emotion and adaptation R. Lazarus 1999 NY oxford University press
[24] Intelligence émotionnelle et management I Kostou 2012 Ed. de Boeck p.29
[25] L’erreur de Descartes : la raison des émotions, Antonio R. Damasio Paris, Odile Jacob, 1995, ,
et Le Sentiment même de soi : corps, émotions, conscience, Antonio R. Damasio, Paris, Odile Jacob, 1999,
[26] Ilios Kotsou op. ci
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية